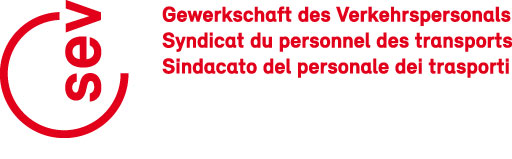Angle droit
Résidant en France – licencié en Suisse
Lorsqu’une personne réside en France, mais travaille en Suisse, elle fait partie de ce qu’on appelle les frontalier·es. En cas de résiliation du contrat de travail en Suisse, ces personnes se retrouvent entre deux systèmes sociaux : celui de la Suisse et celui de leur pays de résidence. Cette situation particulière est encadrée par l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’Union européenne, ainsi que par le Règlement (CE) no 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

De la situation décrite ci-dessus, il découle des règles de compétence précises, mais aussi une responsabilité individuelle claire. Voici les points les plus importants à retenir.
1. Les frontalier·es au chômage doivent s’inscrire auprès du service public de l’emploi français (France Travail, ex-Pôle emploi), dans leur lieu de résidence, et non en Suisse. Cette inscription doit être effectuée sans tarder, car un retard peut entraîner des pertes financières.
2. Étant donné que la personne concernée n’a pas cotisé au système social français pendant son activité en Suisse, elle doit prouver les périodes d’assurance accomplies en Suisse. Cette preuve se fait au moyen du formulaire européen « PD U1 », à demander auprès de la caisse de chômage compétente en Suisse ou auprès du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Il est de la responsabilité de la demandeuse ou du demandeur d’obtenir ce document, qui est indispensable pour que France Travail puisse calculer les droits au chômage correctement.
3. Même si l’allocation chômage française est calculée sur la base du salaire précédemment perçu en Suisse, elle est souvent inférieure à celle qui aurait été versée en Suisse. En Suisse, l’indemnisation représente généralement 70 à 80 % du salaire brut assuré, tandis qu’en France, un mode de calcul différent s’applique, combinant un montant journalier fixe et un pourcentage du salaire antérieur. Le montant perçu est donc fréquemment plus bas.
4. Pendant la période d’indemnisation par France Travail, la personne est automatiquement affiliée au régime français d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’assurance dépendance. L’assurance maladie suisse – généralement une assurance LAMal – doit être résiliée. Une double assurance est interdite et entraînerait des frais inutiles.
5. La fin de l’activité salariée signifie également la sortie de la caisse de pension suisse (2e pilier). Les personnes souhaitant continuer à se couvrir contre les risques d’invalidité et de décès peuvent le faire volontairement via la Fondation Institution supplétive LPP. Cela nécessite une résidence dans un pays de l’UE ou de l’AELE (comme la France), que l’ancien employeur soit soumis à la LPP, et que la demande soit déposée dans un délai de six mois après la fin du contrat. Les primes sont à la charge de l’assuré·e.
6. L’avoir de vieillesse existant dans la prévoyance professionnelle suisse (2e pilier) peut être transféré sur un compte ou une police de libre passage auprès d’une banque ou d’une assurance en Suisse. Les fonds y restent jusqu’à un nouveau cas de prévoyance (par exemple, la reprise d’une activité avec une nouvelle caisse de pension), la retraite ou, dans certains cas exceptionnels, un versement en espèces.
Être frontalier·e signifie naviguer entre deux systèmes. Mais en étant bien informé·e et en agissant à temps, il est possible d’éviter des désavantages et de mieux gérer cette période de transition.
Service juridique du SEV