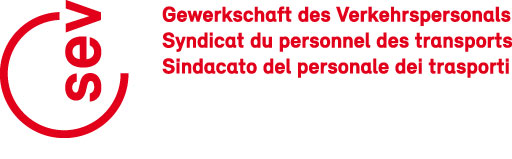Climat et Transition Juste
Une transition avec et pour les gens
Durabilitas, le laboratoire suisse de réflexion et d’expérimentation dédié à la durabilité, mobilise une large variété d’acteurs dont les syndicats pour mettre l’idée de « Transition Juste » à l’agenda politique et à intégrer la justice dans les processus de transition socio-écologiques afin de les rendre plus équitables et mieux acceptés.
Pour lutter contre le changement climatique, les politiques mettent en œuvre de façon technocratique des politiques de transition visant à réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Jusqu’ici avec peu de succès.
En France, le mouvement des Gilets jaunes en 2018 a clairement montré que fin du monde et fin du mois peuvent être en opposition si le gouvernement impose à une population hors des centres urbains dépendante de la voiture une augmentation massive du prix des carburants automobiles au nom du climat. En Suisse, la loi sur le CO₂ soumise au vote populaire en juin 2021 a été rejetée, principalement parce qu’elle contenait des mesures incitatives, dont une taxation, jugées trop contraignantes par une majorité de la population, notamment rurale.
Ces deux exemples démontrent que des politiques de transition prises sans intégrer l’idée de Transition juste, et donc sans se soucier des implications socio-économiques et des injustices qu’elle peut créer, sont vouées à l’échec. C’est ce que constate Nils Moussu, chargé de programme à Durabilitas, le Think & Do Tank politico-scientifique à but non lucratif dédié à la durabilité : « en examinant ces situations de près, un constat récurrent peut être fait : le manque de prise en compte des enjeux de justice sociale. Au contraire, l’idée de Transition Juste soutient qu’une transition écologique ne se fera pas sans justice. En d’autres termes, la réduction des injustices lors des processus de transition est la condition même de ces transitions. »
À l’origine, une idée syndicale
L’idée de transition juste n’est pas à proprement parler une nouveauté puisqu’elle trouve ses origines dans les luttes syndicales étatsuniennes des années 80 revendiquant la création d’un fonds de soutien aux travailleurs mis au chômage en raison de l’impact environnemental de leur secteur d’activité (pétrole, chimie et nucléaire). L’idée est aujourd’hui largement diffusée et fait partie par exemple de l’Accord de Paris sur le climat de 2015. L’Organisation internationale du Travail (OIT) plaidait ainsi à l’ONU lors de la COP 29 fin 2024 : « Les politiques de transition juste doivent donner la priorité aux droits du travail et au travail décent. » Durabilitas fait néanmoins le constat qu’en Suisse « le caractère vague, voire l’absence des enjeux de justice sociale dans les politiques environnementales suisses est flagrant. » Or, si les personnes modestes et vulnérables contribuent relativement moins à la dégradation de l’environnement, elles sont surexposées à la pollution et à un environnement dégradé. Un article du Temps (8.3.25) montrait récemment le contraste entre deux villes genevoises. Vernier d’un côté, où vit la population la plus pauvre du canton, a été longtemps traitée comme la « poubelle » et le tout-à-l’égout des Genevois, coincée entre le survol des avions, des citernes pétrolières et des zones polluées. Vandoeuvres de l’autre côté, commune huppée de la rive gauche genevoise, en pleine campagne, n’a pas toutes ces nuisances et bénéficie d’un parc splendide et de bons transports publics. On comprend bien que les politiques environnementales ne vont pas toucher de la même manière ces deux populations-là.
Durabilité et justice sociale
Si l’inaction et ne pas entreprendre de transition aura des conséquences négatives bien documentées, les politiques de transition peuvent également comporter des risques d’accroissement des inégalités sociales. Durabilitas attire l’attention sur ces risques de transition souvent peu visibles. Il faut évaluer comment les politiques environnementales touchent de manière différenciée les individus et les groupes. Il convient donc de lutter contre l’aveuglement social de ces politiques : « Une Suisse durable est impossible sans justice sociale. » Il faut placer les droits sociaux et la participation au cœur des politiques environnementales. On est encore loin du compte avec des approches qui visent une « acceptabilité sociale » plutôt que de chercher à réduire les inégalités environnementales. Durabilitas le résume ainsi : « La transition socio-écologique ne peut se faire sans et contre les gens. »
Tables rondes
En Suisse, deux tables rondes ont été organisées en mai à Lausanne et Berne pour présenter et discuter cette notion avec différents acteurs de la société civile – ONG, syndicats, administrations publiques, recherche, etc. Le SEV était présent et y a défendu l’idée que le transport public est une des solutions contre le dérèglement climatique. Il a montré que la question de la justice sociale est liée à ce défi environnemental. Au centre de l’attractivité des métiers du transport se trouvent les questions essentielles de la santé et des conditions de travail des salarié·es qui doivent s’améliorer.
Après les deux phases d’élaboration du projet et de mobilisation d’une large variété d’actrices et acteurs, une troisième phase va débuter pour inscrire la justice sociale, les droits sociaux et la participation au cœur des politiques environnementales. Il s’agit de travailler à des méthodes de diagnostic de risques en lien avec les travailleurs eux-mêmes, p. ex., sur les effets de la canicule ou des mesures pour une mobilité décarbonée en pensant aux conditions de travail des acteurs de cette mobilité. Cela passe par l’identification en commun de l’exposition aux risques avec les travailleurs et leurs représentants. Pour que la Transition Juste ne soit pas juste une transition.
Yves Sancey