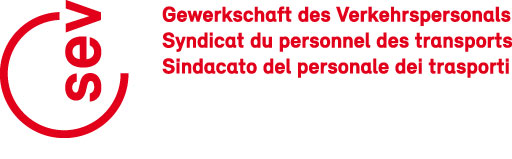Libéralisation du rail sous la loupe
Évolution défavorable en Suède
Qu’a apporté la libéralisation du rail en Suède ? La chercheuse suédoise Malin Malm s’est penchée sur cette question pour l’institut Katalys. Les résultats montrent que 40 années de libéralisation des marchés et de dérégulation n’ont amené aucune amélioration. Bien au contraire. Aujourd’hui il est nécessaire et urgent d’envisager une réorientation afin de renforcer le rail, pour lui permettre de relever les défis du futur.
Le rapport intitulé « Market reforms at the end of the road : How we create a functioning railway for the 2030s» de Malin Malm analyse l’évolution du secteur ferroviaire, en particulier en Suède et en Europe de manière générale. Partout en Europe, le chemin de fer est un moyen de transport efficient sur le plan énergétique offrant une grande capacité de transport des marchandises et des voyageurs. Il joue un rôle central dans l’organisation civile et militaire pour les situations d’urgence, comme dans la guerre en Ukraine où il a grandement contribué aux évacuations et au transport des équipements. Toutefois, le rail demande plus d’investissements et s’avère moins flexible que d’autres moyens de transport comme la voiture ou l’avion. Il exige une planification à long terme et une infrastructure bien développée avec les coûts que cela sous-entend.
Le rail s’est développé en Europe dès la nationalisation au XXe siècle, qui a favorisé l’efficience et la coordination. Puis dans les années 80 la dérégulation a fait son apparition, d’abord en Suède où la séparation entre l’infrastructure et l’exploitation a été introduite dès 1988. Ces réformes ont progressé ensuite dans l’UE dans le cadre de quatre Railway Packages qui ont encouragé la concurrence et l’ouverture des marchés.
Problèmes de la libéralisation des marchés
Malin Malm cite plusieurs problèmes qui ont vu le jour après la libéralisation des marchés :
Position concurrentielle : le rail a perdu des parts de marché en faveur d’autres moyens de transport comme la route ou le transport aérien. Malgré les objectifs européens d’augmenter la part du trafic ferroviaire, cette dernière stagne, voire baisse.
Socialisation des pertes : les tronçons régionaux non rentables sont financés par les impôts alors que les lignes qui permettent de réaliser des bénéfices sont privatisées. Cela amène une répartition inégale des coûts et des bénéfices.
Conditions de travail : les dérégulations ont amené au personnel ferroviaire de moins bonnes conditions de travail, ce qui a accentué les conflits sociaux et les problèmes liés à la sécurité.
Pas d’attrait pour les investissements privés : le marché est dominé par une poignée de grandes entreprises étatiques qui se concurrencent entre elles. Les entreprises privées ne sont pas ou très peu attirées.
Difficultés d’organisation dans les situations d’urgence : la fragmentation du système rend plus difficile la mobilisation des ressources en situation de crise.
Exemples de succès et réorientation
L’Espagne est un exemple positif, les investissements dans les lignes à grande vitesse y ont amené des prix de billets plus bas et plus de voyageurs. L’Espagne dispose du plus grand réseau à grande vitesse d’Europe, ce qui a renforcé la capacité concurrentielle du rail. Le rapport argumente que ce succès est dû aux investissements dans l’infrastructure plutôt qu’à la libéralisation du marché.
Dans son rapport, Malin Malm recommande une réorientation de la politique ferroviaire européenne et propose trois priorités principales :
Priorisation des bénéfices publics : le train devrait être considéré en tant qu’infrastructure publique qui est utile à la société. Le principal objectif ne devrait pas être la concurrence mais la promotion de l’intérêt public, en particulier en ce qui concerne l’organisation dans les situations d’urgence et la protection du climat.
Renforcement de la capacité concurrentielle européenne : les intérêts des voyageurs doivent être placés au-dessus des intérêts des compagnies ferroviaires. Les structures de monopole doivent être régulées afin d’améliorer l’efficience et l’accessibilité du système.
Garantie de bonnes conditions de travail : des conditions de travail durables, stables et équitables sont incontournables pour la sécurité et la fonctionnalité du système ferroviaire. Les syndicats et les CCT doivent être respectés afin de réduire les conflits et d’augmenter l’attractivité du secteur. Le rapport conclut que l’orientation axée le marché et la concurrence n’a pas livré les résultats escomptés. Au lieu de cela, la politique ferroviaire devrait plutôt miser sur les bénéfices publics, la collaboration européenne et le développement social durable. Une nouvelle stratégie de l’UE pourrait jeter les bases d’un système ferroviaire solide et durable capable de relever les défis des années 2030.
Michael Spahr